« Ce livre a créé beaucoup de réactions négatives chez mes amis bourgeois, parce qu’ils pensaient que je les attaquais. » En septembre dernier, Adrien Naselli publie Et tes parents, ils font quoi ?, une enquête sur les transfuges de classe et leurs parents. Dans ce premier ouvrage, le journaliste passé par France Inter, France Culture, Le Monde ou encore Têtu, raconte les parcours de ceux qui, comme lui, ont déjoué les statistiques de la reproduction sociale. S’y croisent les histoires de Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice, fille de Mareme Diallo, professeure de couture en Seine-Saint-Denis ; celles de David Belliard, adjoint écolo à la mairie de Paris et fils de Martine Belliard, ancienne aide-soignante ; ou encore celles d’Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture et fille d’Odette Filippetti, intendante de collège. Adrien Naselli commente :
« On ne donne jamais la parole aux parents de tous ces gens qui ont réussi. Alors que ce sont eux qui ont forgé cette réussite, souvent sans s’en rendre compte. »
En tout, 16 familles ont accepté de se raconter dans ce livre, où se croisent personnalités et anonymes. L’auteur a, lui, joué le jeu de la première personne, pour raconter son enfance en banlieue de Grenoble ; son père chauffeur routier, qui s’est cassé le dos au travail ; sa mère, secrétaire dans un hôpital ; son passage dans les prestigieuses écoles de l’ENS et du CFJ ; son entrée dans l’intelligentsia parisienne et ses troubles face à ce nouveau milieu social. « Aux premières loges pour témoigner de la violence d’un système qui classe, exclut et élit, certains transfuges estiment qu’on ne leur a pas tout dit sur les conséquences de leur ascension sociale », explique Adrien Naselli au début de son ouvrage.
« Comme dans tous les contes de fées, on n’obtient rien sans contrepartie. Pour que le sortilège fonctionne, il faut en payer le prix. Vivre avec deux identités pour le restant de ses jours. »
Qu’est-ce que veut dire « transfuge de classe » ?
La définition de base est : quelqu’un qui a changé de milieu social. Quand on en parle, c’est pour parler d’une ascension sociale – on ne parle jamais de quelqu’un qui est descendu.
C’est d’ailleurs un tic très drôle que j’ai rencontré dans la bourgeoisie. On m’a reproché de ne pas parler des gens qui sont descendus, en ajoutant des : « Moi, mes parents sont diplomates et je n’ai qu’une licence »… Mais les implications ne sont pas les mêmes quand tu montes ou quand tu descends. Les gens ne descendent jamais vraiment. Et la plupart de ceux qui descendent en font souvent le choix. Ce qui se défend ! Par contre, il faut assumer que ça n’est pas une déchéance dans la hiérarchie sociale, mais un choix motivé.
Dans le livre, tu ne t’es donc intéressé qu’aux transfuges qui ont grimpé les échelons.
Je ne me suis intéressé qu’au mouvement que je connais, celui où les parents se sentent à la traîne. Dans notre démocratie, on appelle les gens à faire ce qu’ils veulent et à donner le meilleur d’eux-mêmes, à croire en leur rêve. Je me suis rendu compte que c’est un processus hyper solitaire, puisque le ou la transfuge de classe monte mais n’embarque pas vraiment sa famille avec elle.
Qui est transfuge de classe ?
Tout le monde a des ressentis sur sa classe sociale. Quand on rencontre quelqu’un, on peut parler pendant des heures de son rapport à ses parents. Mais j’avais besoin d’un critère très précis. Je me suis donc concentré sur les études. Pour le livre, je n’ai pris que des familles où les parents ont maximum le bac et les enfants ont fait des études supérieures. Parce que les études donnent une validation, un tampon, une entrée dans les classes supérieures.
Dans ma famille, je suis le seul à avoir des diplômes avec ma petite sœur. Je vois bien les laissez-passer que j’ai à certains endroits, que mes parents n’auront jamais. Mais il faut côtoyer plusieurs milieux, sinon tu ne peux pas le voir.
Quand tu as contacté les gens qui se racontent dans le livre, quelle a été leur réaction ?
Quand c’étaient mes copines, comme Pascaline Bonnet [qui est attachée de production à France Culture], c’est une discussion qui existait déjà. On parlait ensemble des enfants de bourges de France Culture. Et je lui avais dit que je projetais de faire un livre sur ces sujets. Elle m’a encouragé, a suivi le projet et quand je lui ai dit que j’aimerais bien qu’elle soit dedans, elle m’a dit : « Oh, ok… Je vais réfléchir et en parler à ma mère, pas sûr qu’elle accepte ».
À chaque fois, j’ai eu ce temps d’attente un peu stressant en me demandant : Est-ce qu’ils vont accepter ? Est-ce qu’ils vont comprendre le projet ? Certaines personnes m’ont dit non, car ils pensaient que c’était de l’exhibition. C’est ce que disent les personnes de classes populaires en général, dont mes parents : raconter sa vie c’est impudique. Ce qui est le contraire de notre travail de journaliste.
Dans ce livre, tu racontes ton histoire et celle de ta famille et tu as interviewé tes parents.
Oui. Au début, mes parents ont cru que je voulais les afficher. J’ai dû expliquer que c’était pour les défendre et pour montrer aux classes supérieures que je fréquentais à quel point l’accès à leurs sphères est compliqué. Je voulais aussi leur donner la parole, parce qu’on ne leur donne jamais.
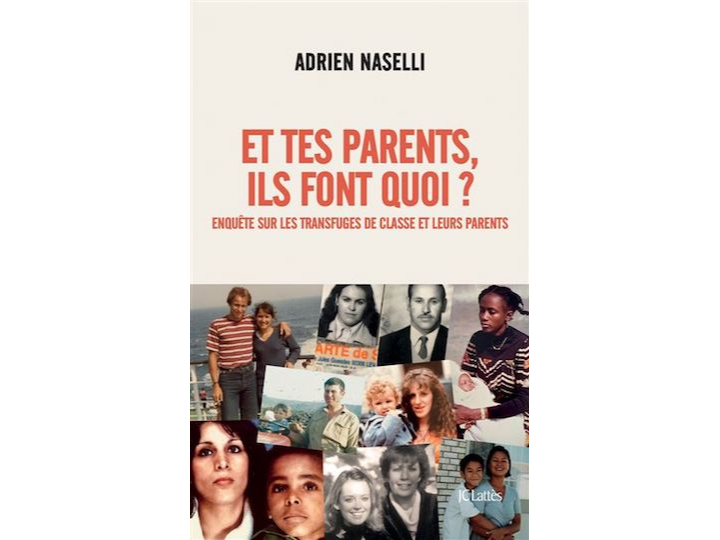
En septembre dernier, Adrien Naselli a publié Et tes parents, ils font quoi ?, une enquête sur les transfuges de classe et leurs parents. / Crédits : Adrien Naselli - JC Lattès
Est-ce que toutes ces familles avaient déjà abordé la question du transfuge de classe ?
Souvent non. Ça n’est pas des choses qu’on dit au repas de Noël ou pendant les dîners de vacances. « Au fait, j’ai changé de milieu. Je fréquente d’autres gens. » Ce sont des choses indicibles. On joue davantage la mascarade du « rien n’a changé ».
D’autres gens ont rompu ou se sont fait larguer par leurs familles, parce qu’ils étaient devenus bourgeois. Certaines personnes m’ont dit qu’ils ne parlaient plus à leurs parents. Là est la limite de mon travail. Je ne pouvais pas – tel un chacal – aller retrouver ces parents. Je leur devais un minimum de bienveillance. Mais, du coup, il n’y a que des familles qui se parlent dans mon livre.
Le livre commence sur cette phrase : « Depuis mon irruption à Paris, pour faire l’ENS, je tiens une liste des gens comme moi. (…) Ils n’ont aucune raison d’être là. Leurs parents ne sont ni ingénieurs, ni galeristes, ni journalistes, ni profs, ni chirurgiens, ni chefs d’entreprise, ni diplomates, ni banquiers, ni spécialistes de littérature médiévale ». Est-ce que cette liste a vraiment existé ?
Elle était vraiment désordonnée… J’ai commencé cette liste quand j’ai quitté Grenoble pour Paris. Je venais d’avoir le concours de l’ENS et j’avais toujours un train de retard par rapport au reste de la promo. Je n’étais ni brillant ni érudit. En latin, par exemple, j’étais au chapitre trois quand tous les autres parlaient couramment… Je n’aurais pas pu passer l’agrégation parce que je n’avais pas le temps de la réviser avec mon travail à côté pour payer mes études. Alors j’ai toujours fait en sorte de me différencier pour être sur un autre level. Avec un mémoire sur Mylène Farmer, par exemple – Mes profs et mes camarades ne savent même pas qui c’est. Ils en ont rigolé et m’ont considéré comme l’original. Et j’ai toujours été l’original dans tous les parcours que j’ai faits.
Entre originaux, on se reconnaît en quelque sorte. À chaque fois que je me disais celui-ci ou celle-là n’a pas l’air d’être très dégourdi, je me renseignais et je notais leur nom dans mon agenda. Il y a ensuite eu les notes dans mes téléphones. J’en ai évidemment perdu beaucoup avant de faire le livre.
Tu expliques aussi qu’il est récurrent de voir les personnages publics réévaluer leurs origines sociales à la baisse. Et tu ajoutes : « À cause de tous ces malentendus sur la classe dans notre pays, j’ai développé une frénétique obsession pour le métier des parents des gens qui font l’actualité ».
J’ai effectivement cherché dans les personnalités, les artistes, les gens médiatiques. Et j’ai découvert que personne ne répondait aux critères de mon livre. Quand tu regardes les journalistes, du soir au matin dans les télés, les radios et la presse, et ceux qu’ils interviewent – les gens visibles en fait – tous sont de milieux favorisés. Je pense que dans cette sphère, une personne sur dix seulement entre dans les critères du livre.
La reproduction sociale est énorme en France et on vit très bien avec ! En tant que journaliste, on fait toute la journée des papiers sur les enfants de chanteurs et chanteuses – que par ailleurs j’écoute, ça n’est pas un rejet. Mais il est flagrant de le constater. Je trouve ça nécessaire de replacer les gens dans tous ces papiers : il s’agit du fils ou de la fille de. Y compris concernant les gens qui mènent des combats contre l’homophobie, le racisme ou le sexisme, puisque la plupart des profils à la tête des assos sont des enfants de CSP+. On oublie trop souvent de leur demander d’où ils viennent. Pourtant, ça n’est pas un hasard qu’ils et elles ont la possibilité de prendre la parole et d’être dans la lumière. C’est que beaucoup de choses les ont menées à cette position.
Je prends souvent l’exemple d’Yseult. Une chanteuse que j’adore ! Mais c’est très rare de rappeler qu’elle est la fille d’un cadre supérieur de Land Rover et qu’elle allait à l’école maternelle en Mercedes. Les stéréotypes et les clichés font qu’on lui attribue une autre identité.
Ça n’est pas vraiment de son fait…
Quand on lui demande, effectivement, elle le raconte. Mais c’est plutôt une critique faite aux médias. Les journalistes la vendent comme le renouveau militant de la scène française. J’aimerais bien qu’on précise qu’elle vient d’un milieu richissime et qu’elle a pu ouvrir sa gueule. Je ne dis pas ça parce que je pense qu’Yseult devrait arrêter d’ouvrir sa gueule, bien au contraire ! C’est simplement pour déculpabiliser tous les autres qui ne peuvent pas être Yseult – parce qu’ils n’ont sûrement pas son talent, mais aussi et surtout parce qu’ils n’ont pas la possibilité d’accès à ça.
Même si ces gens s’en plaignent et disent être ramenés injustement à leurs origines, je pense que ça fait partie de leur histoire et qu’il est nécessaire de le rappeler. Pour moi, c’est de la désinformation de ne pas le faire. Je vais jusque-là ! Quand on met en avant telle qualité et tel engagement d’une personne, sans dire d’où elle vient, c’est un travail à moitié fait.
NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,
ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER


