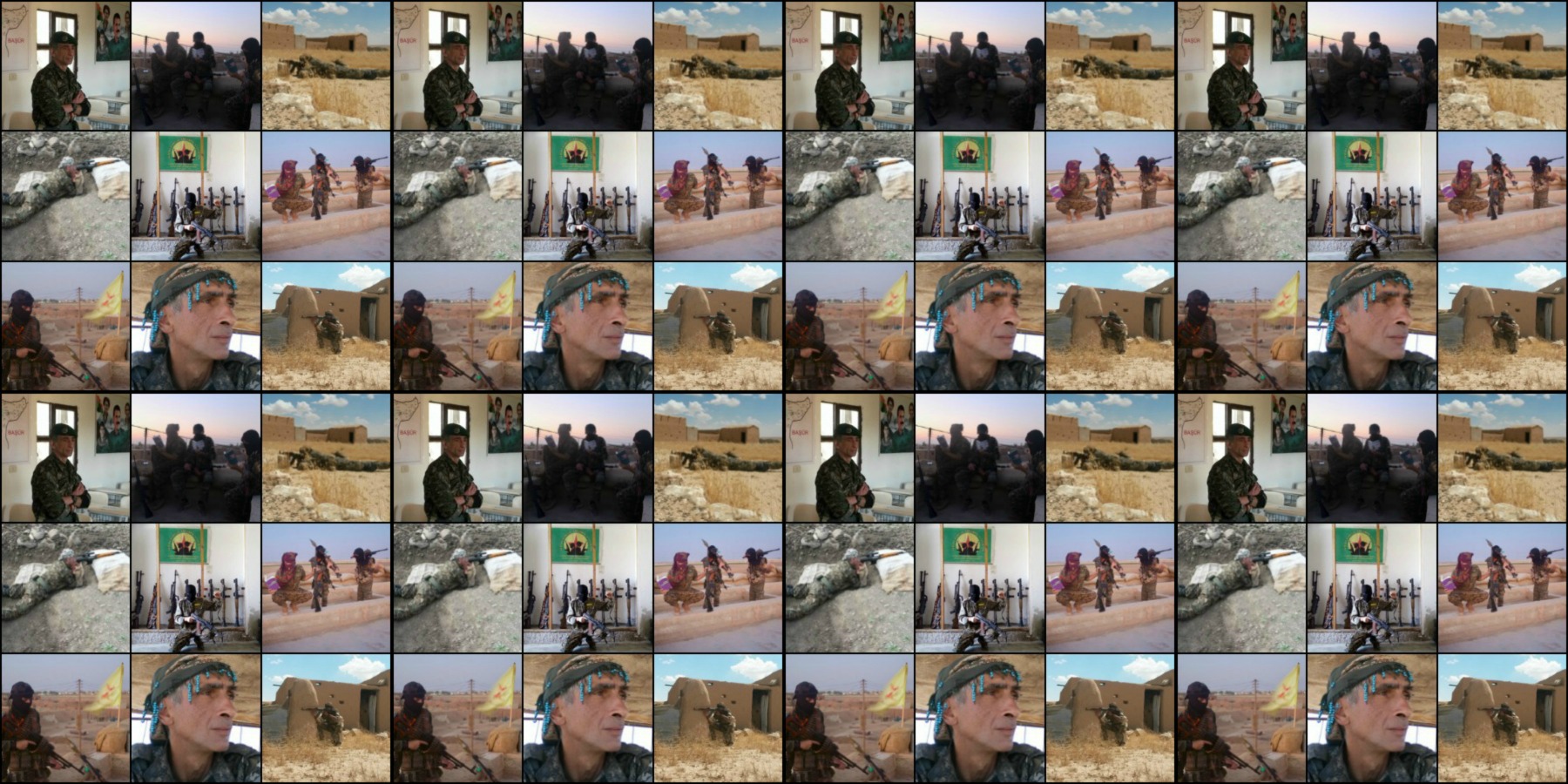Tel Abyad au Kurdistan syrien. Arthur*, 25 ans, se souvient de ses premiers jours en Syrie :
« J’ai vu la montagne à côté de moi se faire exploser par des bombes. Ils ont tué 18 personnes. Le soir, planqué dans mon trou, je ne pouvais rien faire d’autre qu’apprendre à me relâcher et me dire que je ne pouvais pas être maître de tout. »
Ce mardi 25 avril 2017, l’armée turque bombarde aux abords de la ville frontalière d’Al-Malikiyah. Le jeune français, diplômé en sciences sociales, n’a rejoint les troupes kurdes qu’à peine une dizaine de jours plus tôt.
Selon les estimations, entre 150 et 300 volontaires étrangers sont partis se battre aux côtés des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition militaire regroupant des milices arabes autour des Kurdes des Unités de protection du peuple (YPG). Objectif : chasser Daesh de la zone frontalière avec la Turquie. Parmi eux, une poignée de Français.
C’est par Skype que le grand gaillard au léger accent du Nord nous raconte son quotidien en zone de guerre. Ce jeudi d’août, Arthur se repose à Tel Abyad, où est située la base-arrière du Bataillon international de la libération (IFB), son régiment :
« On s’entraîne au combat, on s’occupe des tâches ménagères et on joue au volley avec les Kurdes. »
Mais quelques jours plus tôt, le militant « communiste-libertaire » participait à l’encerclement de Raqqa, la « capitale » de l’auto-proclamé Etat Islamique.
Le Rojava
Dès 2014, Arthur prend la décision de partir. « Le grand déclencheur pour moi, ça été la seconde bataille de Kobané », dit-il. Pendant la période des fêtes, les rebelles kurdes repoussent les djihadistes hors de la ville :
« Je connaissais déjà l’histoire du peuple kurde et sa lutte pour l’indépendance. Mais là, j’ai réalisé qu’il se passait vraiment quelque chose et j’ai commencé à me rapprocher des communautés kurdes de ma ville. »
(img) Julien plie le genou 
Si certains militants de la gauche radicale rejoignent les rangs de cette armée proche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), c’est qu’au Rojava, les rebelles kurdes tentent d’installer un système politique indépendant mais surtout autogéré et égalitaire. Mais en attendant de vivre pleinement cette utopie, c’est par les armes qu’ils tentent de reprendre le nord de l’actuel Syrie. En plus de faire face à Daesh, ils subissent les bombardements de l’armée turque qui les qualifie de terroristes.
Dans le viseur des services secrets
Julien*, dont le nom kurde est Serhat Tiqqun, est un autre militant anarcho-communiste de 21 ans. Depuis Tel Abyad, il nous raconte son histoire avant de retourner sur le front. Une conversation interrompue à plusieurs reprises par les coupures de courant. Le petit brun loquace a grandi à la campagne. Il ne dira pas où. Son adolescence se partage entre cours de hip hop et lectures d’Auguste Blanqui (théoricien français de l’ultra gauche) et Karl Marx. Depuis ses 16 ans, il savait qu’un jour il partirait au Rojava :
« J’attendais juste de passer mon bac. Et puis mes parents m’ont convaincu d’aller à la fac. Du coup je me suis dit, autant finir ma licence. Mais je savais que je ne voulais pas rester dans un bureau ou sur les bancs de l’université. »
Pour le militant tête brûlée, « c’est important pour tout révolutionnaire d’avoir une formation militaire minimale ». En parallèle de ses études, il s’engage en tant que réserviste :
« C’est bien de se la raconter derrière son ordinateur et de fantasmer sur la guerre d’Espagne. Mais demain, si les fascistes prennent les armes en France, on ne sera jamais aptes à les contrer. »
Sauf qu’en décembre 2016, quelques mois avant son départ, Julien parle de son projet à un ami « qui n’était pas un camarade », précise-t-il :
« Ce trouillard en a parlé à son père qui a entendu les mots “Syrie” et “lutte armée” et n’a pas fait la différence avec Daesh. »
Le père alerte la police. Julien et sa mère, dévastée, sont convoqués par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), les services secrets français. « J’ai halluciné quand ils ont sorti toutes les infos qu’ils avaient sur moi. Mais ils n’ont rien pu faire car ce que je faisais n’avait rien d’illégal », balaie-t-il. En France, contrairement à la Turquie, le YPG – les Kurdes des Unités de protection du peuple – n’est pas considéré comme une organisation terroriste :
« En plus, on y va bénévolement donc on n’est pas des mercenaires. »
Road trip en direction de la Syrie
Quand Julien et Arthur racontent leur périple, s’envoler pour le Rojava semble presque facile. Les candidats au départ doivent d’abord remplir un formulaire électronique dans lequel ils s’engagent à soutenir la révolution et rester au moins six mois. Il est ensuite conseillé de prendre l’avion depuis un pays situé en dehors de l’espace Schengen, ou peu regardant sur les départs, comme la Roumanie ou la Grèce, avant d’atterrir à Souleimaniye, en Iraq. Arthur raconte la suite :
« Une fois là-bas, on doit jeter notre carte SIM française et attendre à l’hôtel que notre contact vienne nous chercher. »

Julien et ses camarades. /
Il n’attendra que deux jours quand d’autre ont dû poireauter plusieurs semaines. « J’en ai profité pour visiter. C’est très calme et on se sent limite en sécurité », assure-t-il. Par petits groupes de volontaires étrangers, ils montent dans une voiture, direction la Syrie. Ils traversent de nombreux territoires contrôlés par des factions rivales. Les checkpoints se succèdent avec à chaque fois, la peur au ventre. Le périple se clôt sur une journée de marche à pied. « Huit heures dans le désert avec 35 kilos d’équipement sur le dos, c’était bien chiant », rembobine Julien.
Formation militaire et idéologique
En décembre 2016, le petit gars débarque dans un coin reculé du canton de Djézireh où les YPG ont leur « académie ». Ici, les nouveaux arrivants venus des quatre coins du monde croisent ceux qui rentrent au bercail :
« Y a des Polonais, des Américains, des Italiens, des Brésiliens, des Grecs… Ils nous racontent ce qu’ils ont vécu. Niveau internationalisme, c’est plutôt chouette. »
Pendant un mois, c’est régime sec et retour à l’école : sport le matin, cours de kurmandji (l’une des langues kurdes), deux semaines d’idéologie puis deux semaines d’entraînement militaire. « La théorie, c’est surtout des cours de sociologie et d’histoire du peuple kurde », détaille le jeune révolutionnaire. Un gros chapitre est consacré à Abdullah Öcalan. Le leader du PKK, emprisonné en Turquie, fait l’objet d’un véritable culte au Rojava. Et, parce qu’il a théorisé le « confédéralisme démocratique », son aura dépasse largement les frontières. Derrière ce gros mot, un système politique socialiste rejetant l’Etat-nation, organisé à la base, écologique, paritaire et multiethnique.
Militaire à la retraite cherche guerre
Tous les volontaires étrangers ne sont pas des militants de la gauche de la gauche. Loin de là. Certains viennent, disent-ils, par « solidarité », certains pour l’adrénaline, d’autres encore pour « tuer du musulman ». « J’ai entendu parler d’un ancien marine américain supporter de Trump », raconte Arthur, à moitié amusé. Son acolyte nuance :
« Après, y a pas mal d’anciens militaires, surtout des Américains, qui étaient plutôt réac’ et qui sont devenus des camarades. »
Jean-Pierre*, Serhad Cheenook de son nom kurde, est l’un de ces anciens militaires parti soutenir les YPG. À 53 ans, ce légionnaire à la retraite est parti sept mois, de janvier à août 2016. L’utopie politique, très peu pour lui :
(img) Jean-Pierre, 53 ans et retraité 
« Moi, la politique ça ne m’intéresse pas. »
« J’ai pensé que je pouvais être utile », justifie cet ancien infirmier militaire passé par de nombreux fronts. « J’ai fait la première guerre du Golfe et la Centrafrique mais là, c’est incomparable », raconte le soldat de métier :
« Déjà, je suis parti en bénévole, sans filet de sécurité, considéré comme un terroriste par la Turquie. J’ai d’ailleurs fait 13 jours de prison en Irak à mon retour. Et sur place, on ne travaille pas avec une armée structurée mais avec une sorte de guérilla jeune et mal équipée. »
Le gradé à la crinière grisonnante décrit le manque de nourriture et de matériel médical :
« Pour transporter les blessés, on n’avait aucun moyen aérien, tout se faisait par route, j’ai rarement vu ça. Je suis rentré de Syrie amaigri et affaibli. »
Jean-Pierre, toujours en contact avec ses compagnons restés au front, demeure pourtant optimiste :
« C’est une révolution qui a de bonne chance d’aboutir et qui est un plus pour la démocratie. »
Le bal des mythos
Un autre spécimen de volontaires étrangers hante les rangs des YPG. « Je les appelle les “poseurs”, ce sont les pires », peste Serhat Tiqqun :
« Ils font leur mois de formation, prennent des photos et repartent direct. Il y a un Français que j’ai vu passer qui raconte sur Facebook qu’il a tué plein de mecs de Daesh et qu’il est rentré parce qu’il a pris du soufre à Raqqa. Ce mytho n’a jamais mis les pieds sur le front. »
(img) Jean-Pierre au travail ! 
Ces « touristes de la guerre » représenteraient, selon lui, près d’un tiers des effectifs de l’académie. Au Rojava, ils n’ont pas vraiment bonne presse :
« C’est insupportable de voir ça quand t’as des camarades qui sont morts et qui resteront anonymes toute leur vie. »
L’horreur de la guerre
A ne pas confondre, insiste Arthur, avec certains de ses camarades occidentaux traumatisés par leur premier combat, qui préfèrent rester à l’arrière et travailler dans le civil. Car, quelle que soit la cause ou l’ennemi, la guerre fait des dégâts dans les têtes. La peur des explosions qui ne préviennent pas. Les cadavres qui s’accumulent. « A cause de la chaleur extrême et du fait qu’ils sont déshydratés, ils ont quelque chose de surréaliste », raconte-t-il. Et puis l’odeur de mort et d’excréments qui inonde Raqqa :
« Quand les gens meurent, ils se chient dessus. Cette ville pue la merde. »
Arthur assure pourtant que ses nuits ne sont pas trop peuplées de cauchemars. « J’ai dû être assez bien préparé par les jeux vidéo ou les films d’action mais moi ça va, j’arrive encore à dormir », lance, un poil ironique, le fan de western.
Julien, lui, admet avoir perdu son insouciance. En avril, il participe à l’assaut de Kalta, village proche de Raqqa. Depuis les tranchées, il aperçoit le drapeau de l’EI qui flotte à moins d’un kilomètre :
« On se tirait dessus la journée et un soir, on a trouvé leur fréquence sur le talkie-walkie. J’en ai entendu un parler en français, c’était assez fou. »
Back to Paris
Les combattants internationaux servent de vitrine au Kurdistan syrien. A leur retour ou depuis le Rojava, ils diffusent auprès de leur pays l’image de bataillons progressistes, partis combattre pour une « utopie concrète ». C’est sans doute aussi dans ce but qu’ils ont accepté de se livrer à StreetPress sans éluder aucune question, à la seule condition que nous préservions leur anonymat.
Arthur espère, sans trop y croire, être resté sous les radars des services de renseignement. Il devrait retrouver la France dans les semaines qui viennent. Il veut transmettre son expérience au milieu militant :
« Certains ont une vision idéalisée du Rojava, c’est important de dire que la révolution est en cours mais qu’elle n’est pas parfaite ou comme on l’imagine. »Et de citer en exemple l’égalité femmes hommes. Bien « réelle » mais « il ne s’agit pas d’un féminisme occidental et la pudeur de mise dans une société traditionnelle est toujours très présente ».
Julien, quant à lui, regarde se tourne déjà vers d’autres horizons :
« Je vais sans doute aller en Grèce ou au Chiapas avant de revenir ici. Mais je n’ai plus rien à faire en France, il ne se passe rien là-bas. »
* Les prénoms ont été modifiés.
NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,
ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER