« N’espérez pas qu’Impunité Zéro soit une lecture agréable. » Le livre commence par ces mots. Les suivants sont glaçants. A travers six enquêtes, neuf journalistes françaises reviennent sur les violences sexuelles dans les conflits armés. Elles touchent les femmes et les enfants, surtout. Mais elles n’épargnent pas les hommes, torturés dans les prisons secrètes de la CIA ou ailleurs.
En Syrie depuis la révolution, en Ukraine pendant la guerre du Donbass, en Centrafrique avec les troupes françaises, mais également devant les tribunaux nationaux et internationaux, l’impunité des auteurs de viols de guerre est totale. Un système bien rodé qui empêche les victimes de témoigner et d’obtenir justice. « Impunité Zéro est un projet d’investigation et d’activisme contre cette impunité », raconte Justine Brabant, qui a travaillé sur les agissements des soldats français pendant la mission Sangaris en République centreafricaine.
Impunité Zéro
Un livre de Justine Brabant, Leïla Minano, Anne-Laure Pineau. Avec Cécile Andrzejewski, Delphine Bauer, Hélène Molinari, Ariane Puccini, Ilioné Schultz, Sophie Tardy-Joubert.
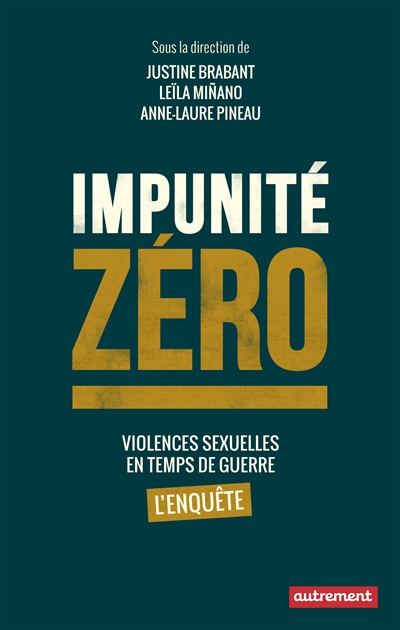
Les enquêtes :
>> USA : LES VIOLENCES SEXUELLES COMME MÉTHODE DE TORTURE
>> SYRIE : LES VIOLS D’ENFANTS, L’AUTRE CRIME DU RÉGIME D’ASSAD
>> LES OUBLIÉES DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Toutes les enquêtes sont à lire sur
www.zeroimpunity.com
A l’origine de ce projet transmédia, la société de production militante aBAHN. « Ils voulaient qu’un collectif de 9 femmes journalistes investissent ce sujet. Ils ont ensuite prolongé notre travail pour en sortir des mesures concrètes », raconte Anne-Laure Pineau, qui a documenté la mise en place des tortures sexuelles par les États-Unis, après le 11 septembre 2001. Leurs enquêtes ont été traduites dans 6 langues et publiées dans une quinzaine de pays, un film devrait sortir au premier semestre 2018. Quatre pétitions en ligne, en rapport avec les enquêtes, ont récolté, au total, plus de 400.000 signatures. [Pour sensibiliser les militaires sur les violences sexuelles ; mettre fin aux stratégies de violences sexuelles contre les enfants en Syrie ; pour une fin à l’impunité des États-Unis en matière de violences sexuelles ; pour aider les victimes à obtenir justice en Ukraine]. Ce qui a fait bouger les lignes. « Un projet de loi va bientôt être déposé au parlement ukrainien pour que ces violences soient sanctionnées », précise Hélène Molinari :
« C’est encourageant, ça prouve que les choses peuvent bouger. Et c’est une des raisons pour laquelle nous nous sommes toutes lancées dans ce projet. »
Pour StreetPress, les trois journalistes reviennent sur leurs mois d’investigation.

De gauche à droite, Justine Brabant, Hélène Molinari et Anne-Laure Pineau. /
Vous racontez plusieurs agressions sexuelles commises par des militaires français en Centrafrique. Y-a-t-il eu des condamnations ?
Justine : Il n’y a eu aucune et il n’y en aura aucune. 3 dossiers ont été ouverts en France. Le premier a été classé sans suite. Fait d’autant plus surprenant qu’il y a un enfant né entre cette jeune fille mineure et le soldat. Mais on n’a pas jugé utile de faire un prélèvement ADN sur l’enfant. Dans le second cas, la plus grosse affaire, celle des 40 enfants du camp de M’Poko [tous ont déclaré avoir été agressés sexuellement par des militaire français, ndlr], on avance vers un non-lieu puisqu’il n’y a pas eu de mise en examen. Le troisième dossier concerne des agressions sexuelles présumées sur un territoire plus au nord et difficile d’accès. Il n’y a pas de nouvelles de l’enquête. Mais il n’y a pas de raison que ça se passe autrement quand on sait qu’à Bangui, juste dans la capitale, une quarantaine d’enfants disent avoir été violés ou agressés par des militaires francais.
Vous racontez que les USA ont passé un cap supplémentaire, en théorisant les agressions sexuelles comme méthode de torture.
Anne-Laure : La torture sexuelle a été élaborée de manière très froide dans le bureau de deux psychologues, James Mitchell et Bruce Jessen. Ils se sont basés sur un système de résistance [pour résister aux tortures en cas de kidnapping] pour soldats américains. Ces deux psys ne sont jamais entrés dans une prison et ne connaissent rien des terrains de guerre, mais ils ont créé un système de torture utilisé dans les prisons secrètes de la CIA. Il y en a en Thaïlande, en Afghanistan, en Europe de l’Est, dans des aéroports, dans un bateau. Mais on n’en sait pas plus, ces infos qui restent encore secret défense.

Anne-Laure Pineau a travaillé sur l'enquête "Comment les Etats-Unis ont choisi la torture sexuelle". /
Qu’ont-ils inventé ?
Anne-Laure : Leur technique préconise de casser le système de défense d’une personne en la mettant “mal à l’aise”. C’est le terme qu’ils ont utilisé. Et dans leur lexique, “mal à l’aise” veut dire jouer avec les terreurs et les tabous des prisonniers. Dans l’imaginaire des Américains, un homme musulman déteste les femmes. Alors on met des femmes nues dans les salles d’interrogatoires. On dit à des femmes soldats d’utiliser leur sexualité, le tabou du toucher ou des paroles sexuelles. On sait, par exemple, qu’ils ont agrafé des photos de magazines pornographiques sur le corps de détenus nus et les ont forcé à se masturber. Il y a eu des viols avec des chiens. On fait des pyramides d’hommes nus, parce qu’ils imaginent que la promiscuité est tabou. Tout est basé sur les clichés et sur la barbarie de deux psychologues.
Plusieurs de vos intervenants parlent “d’un des plus grands scandales médicaux” des États-Unis. Pourquoi ?
Anne-Laure : Des médecins surveillaient et participaient même à ces tortures. Ils surveillaient les viols des détenus, ils faisaient en sorte qu’on utilise l’hydratation rectale comme torture. On a rencontré une association de médecins pour les droits humains qui nous ont assuré que ce sont des procédures qu’on utilise sur des gens qui n’ont plus de rectum ou de côlon.
Comment de telles pratiques ont pu se poursuivre alors que les hauts cadres américains étaient au courant ?
Anne-Laure : Le gouvernement Bush voulait une guerre d’une autre ampleur en Afghanistan. Il voulait une seconde guerre du Golfe. Et il fallait un prétexte pour tomber sur Saddam Hussein. Il ne voulait pas des renseignements mais des aveux forcés. Et la torture était parfaite pour ça. Si on m’enlève tous les ongles, si on me met une sonde, la plus grosse possible, pour me nourrir et m’hydrater, qu’on me met nu sur le sol et qu’on me dit “dis que t’es une pote de Merah”, je le dis, “je suis une pote de Merah”. Ils voulaient des aveux et c’était parfait.
Ces techniques sont-elles toujours utilisées ?
Anne-Laure : Officiellement elles ont été arrêtées en 2005, quand cette fameuse liste de tortures est devenue publique. Mais il y a encore des gens qui se sont fait arrêter et qui ont subi de la nudité forcée et de la nutrition rectale. Pas à Guantanamo, mais dans des prisons irakiennes, par des Américains.
En Syrie, l’armée de Bachar Al Assad s’est attaquée à des enfants. Est-ce avec l’aval de la hiérarchie ?
Justine : La situation en Syrie est un peu différente puisque les ordres sont donnés à demi-mot. Les directeurs de prison donnent l’autorisation de mélanger les détenus mineurs et majeurs. Pendant la révolution, les enfants étaient dans la rue. Pour les responsables politiques, il n’y a pas de raison qu’ils ne soient avec les adultes en prison.
Mais les mélanger veut dire que les enfants sont utilisés comme larbins et sont violés. C’est une sorte de zone grise où les gens savent ce qui se passe, mais laissent faire.

Anne-Pineau, Justine Brabant et Leïla Minano ont chapeauté le projet. /
Pourquoi s’en prendre aux enfants ?
Anne-Laure : Du point de vue des bourreaux, s’attaquer aux enfants c’est créer un choc. Si on va jusqu’à martyriser des enfants, on est capable de tout.
Justine : Les autorités ont d’ailleurs donné l’instruction d’emporter femmes et enfants, lorsqu’un opposant politique n’est pas trouvé chez lui. Et parfois, on ne prend que les enfants. C’est l’histoire de Nora, une petite fille qui a été kidnappée parce que son père était soupçonné de faire partie des révolutionnaires. Elle a passé des jours et des jours en prison. Quand son père s’est rendu, on l’a encore gardée. Dans cette prison syrienne, on lui a administré des traitements hormonaux pour que son corps se développe plus rapidement et pour qu’elle puisse être violée en ayant les attributs d’une femme. Quand elle est sortie, son corps avait tellement changé que sa mère ne l’a pas reconnue.
Quelles vont être les répercussions de tels actes sur la société syrienne ?
Justine : Omar Guerrero, qui est psychologue dans l’un des rares centres qui prennent en charge les gens revenus de Syrie, assure que la principale crainte des médecins est de savoir comment une société va se reconstruire là-dessus. Comment est-ce que des gamins violés par des voisins, des cousins, des gens de la ville d’à côté vont se construire en tant qu’adultes ? Quel rapport auront-ils à la loi, sachant ce que la loi leur a fait ?
Vous interrogez les victimes, bien sûr, mais aussi les oppresseurs, les institutions judiciaires. Tous ceux qui participent à gommer l’existence de ces violences sexuelles. Pourquoi ?
Hélène : Notre intérêt était de s’attaquer au système. Peu importe les terrains de guerre, ou la nationalité des oppresseurs, ces violences sont systématiques.
Justine : Nous voulions également montrer que l’on peut enquêter sur ces sujets. Quand on parle de viol ou de violences sexuelles, il y a souvent cette réaction spontanée : le doute. Pour cette enquête nous sommes allées chercher des certificats médicaux, des témoins, des victimes, des documents qui prouvent qu’il y a des consignes ou non pour ces viols, les périodes concernées, etc. Je pense qu’on a prouvé qu’il est possible d’enquêter sur ces sujets.
Anne-Laure : Mais malgré tout ce travail, a BAHN s’est rendu compte que le premier réflexe des gens reste la mise en doute. Finalement, notre travail est décrédibilisé comme les témoignages des victimes.
Justine : Alors que demain, si quelqu’un vient te voir en te disant “je me suis fait voler mon portefeuille”, tu ne lui dis pas “mmh t’es sûr ? Mais peut-être que c’était plus compliqué que ça. Est-ce que ton portefeuille il était tout nu ?”
Pourquoi cette méfiance est-elle exacerbée en temps de guerre ?
Justine : Les violences sexuelles en temps de guerre sont au croisement de plusieurs points aveugles du journalisme et de la société. C’est une sorte de triangle des Bermudes. D’abord, la première question est de savoir comment l’on traite les violences faites aux femmes, et le viol en particulier, dans nos sociétés. Vient se superposer la question particulière de la guerre, avec ses armées où il y a un esprit de corps très fort. On ne balance pas son pote ! Viennent ensuite très vite les questions de sécurité nationale.
C’est-à-dire ?
Justine : En parler serait dangereux pour les troupes. Face à des images de violences et d’abus, les populations locales vont être hostiles et devenir un danger pour les troupes sur place.
Anne-Laure : Pour exemple, Daesh a fait sa publicité sur les images d’Abou Ghraib, de Guantanamo et sur les costumes de prisonniers oranges. Il est aisé de créer de la haine devant tant de violence.
Justine : Mais si ces soldats n’avaient pas violé ou torturé, les populations n’auraient probablement pas été aussi hostiles… Et puis il y a aussi la question de la justice des vainqueurs. Des agresseurs deviennent ministre, général ou colonel. Est-ce qu’on va vraiment prendre le risque d’aller devant la justice alors que la guerre est terminée et que le pays se reconstruit enfin ?
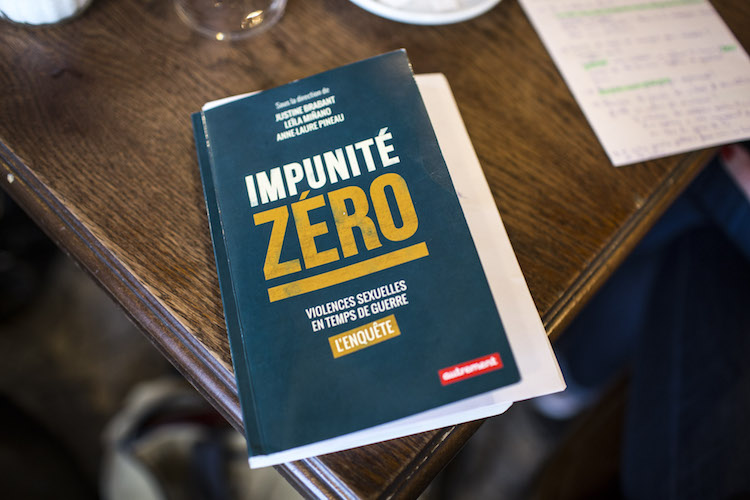
Le livre qui regroupe les 6 enquêtes. /
Vous avez réussi à récolter les témoignages de soldats qui ont violé, de responsables qui ont encadré ou théorisé les violences. Pourquoi acceptent-ils de parler ?
Justine : Il y a beaucoup de gens qui espèrent sauver leur peau vis-à-vis de la justice. Dans l’enquête sur la Syrie, un directeur de prison où étaient organisées des tortures sur des enfants a accepté de témoigner. Il a renié le régime pour lequel il a travaillé pendant des années. Il imagine que ça aidera sa cause d’avouer en partie ce qu’il s’est passé dans sa prison. Et ces gens décrivent souvent les choses techniquement, sans se rendre compte des implications d’un point de vue pénal et criminel.
Comment ça ?
J ustine : Les gens font des choses répréhensibles par la loi, des crimes, en estimant que c’est la moins mauvaise des solutions. Les personnes qui se réjouissent vraiment sont un peu psychopathes et à la marge. Ce qui est assez terrifiant, c’est que des gens peuvent te justifier hyper rationnellement pourquoi ils ont commis un viol.
Comment peut-on trouver une explication rationnelle au viol ?
Justine : En Centrafrique, on te décrit plutôt la chose comme “on revenait du front, ça avait été très difficile, il fallait qu’on se détende”. Les gens ne disent jamais “oui c’est vrai j’ai fait un truc horrible”. Ils estiment toujours avoir de bonnes raisons de le faire. Et c’est pour ça qu’ils parlent assez librement.
Hélène : Cet argument “il faut se détendre” est d’ailleurs noté dans un des rapports de l’ONU, dans les conseils pour régler “les mauvaises conduites” – comme on appelle ces violences – des casques bleus. Selon ce document, il faudrait leur donner plus de loisirs, parce qu’ils s’ennuient, les pauvres… Et donc indirectement c’est pour cela qu’ils violent et qu’ils vont voir des prostitués. C’est un peu le repos du guerrier…

Hélène Molinari a travaillé sur l'enquête "ONU : permis d'abuser". /
Justine : La plupart sont d’ailleurs persuadés de rendre service aux populations. Comme il y a souvent un échange de nourriture, de savons, de quelque chose, les soldats considèrent la chose comme un échange de bons procédés. Il y a souvent des enfants qui traînent autour du camp, qui demandent à boire et à manger. Et bon, de temps en temps, il y en avait un qui…
Hélène : Et puis personne ne dit que c’est mal… Il y a une impunité totale. Quand tu fais un truc pareil et que derrière il n’y a pas de conséquences, pourquoi ne pas continuer ?
Anne-Laure : C’est un peu la banalité du mal d’Hannah Arendt, plus zéro formation des troupes, plus zéro répression, qui créent une sorte de super tempête où l’impunité est effective et à de beaux jours devant elle.
Vous montrez justement que presque tout le monde couvre ces violences. Pourquoi ?
Hélène : Pour l’ONU, la réponse est simple : la réputation, l’image. L’ONU ne peut pas faire sans son image d’organisation mondiale de la paix et de protection des droits de l’Homme. Les hauts responsables donnent d’ailleurs les mêmes excuses qu’un soldat : c’est compliqué, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas s’occuper de ça.
Justine : Les casques bleus sont envoyés par leur pays sur une base volontaire du pays d’origine. L’ONU a déjà du mal à rassembler assez de gens pour ses missions de maintien de la paix. Poursuivre en justice un soldat qui aurait violé, c’est lancer un signal au pays d’origine du soldat de ne plus prendre le risque d’envoyer ses soldats.
Vous avez travaillé sur l’ONU et la difficulté de faire exister les violences sexuelles dans les jugements. Était-ce compliqué ?
Hélène : Étonnamment, on a réussi à avoir la plupart des rendez-vous dont nous avions besoin. C’est une fois sur place que ça a été compliqué. Quand nous sommes arrivées, on nous a annoncé que tous nos rendez-vous d’une heure seraient réduits de moitié. Puis un employé des relations publiques est toujours présent et enregistre toutes les conversations. C’était assez amusant parce qu’il nous a dit “au cas où, si votre enregistreur ne fonctionne pas, je pourrais vous donner le mien”. Alors qu’il voulait simplement vérifier nos questions. Et en plus de tout ce dispositif, quelques heures après, j’ai reçu un appel d’une des personnes des relations publiques pour me dire “on est bien d’accord, tout ce qu’on a dit était du off et vous ne pourrez citer la personne”.

Justine Brabant a travaillé sur l'enquête "L'armée française et l'affaire Sangaris : anatomie d'une non-enquête". /
Et comment avez-vous fait ?
Hélène : J’ai très clairement expliqué qu’il n’y aurait pas de off et que si cette personne avait répondu à mes questions elle allait être citée. On m’a menacée, aussi, d’alerter directement le rédacteur en chef de Médiapart, où paraissaient nos articles à ce moment-là. Je ne crois pas qu’ils l’ont fait finalement.
Justine : Et puis bon, Médiapart…
Hélène : Je pense que l’ONU est habitué à ce qu’on s’écrase devant eux. Ou en tout cas ils ne se gênent pas pour demander aux journalistes de modifier les choses, de passer certaines autres sous silence, de relire.
Et pourquoi répondaient-ils alors ?
Hélène : Parce que ça fait mauvais genre une mention “l’ONU n’a pas voulu répondre à nos questions” j’imagine. Après, honnêtement, j’étais surprise qu’ils nous accordent autant d’interviews. On y est allées en disant qu’on voulait travailler sur la question des “mauvaises conduites”, c’est le terme générique pour parler des agressions sexuelles. Ils étaient d’accord pour nous expliquer comment fonctionnait les enquêtes internes. Mais les questions de violences sexuelles les ont mis extrêmement mal à l’aise. À chaque fois, c’est le même discours : politique de tolérance zéro.
Après les révélations d’agressions sexuelles en Centrafrique, Hollande et Le Drian avaient pris des positions très fermes, pourtant les procès n’aboutissent pas.
Justine : Hollande et le Drian savent qu’ils n’ont rien à perdre à dire qu’ils sont hyper fermes. Et ils misent sur le fait que ni la justice ni les journalistes n’ont le temps et les moyens de retrouver la fille qui a été violée au fin fond de la Centrafrique.
Comme vous le dites dans votre conclusion, “arrivé au terme de cette enquête, une certitude hantera sans doute l’esprit de la lectrice ou du lecteur : il n’y a pas d’espoir”.
Anne-Laure : Dès l’intro on dit que ca ne va pas être facile à lire. Oui le bilan est noir, où qu’on regarde c’est la catastrophe. Mais, encore une fois, grâce aux victimes qui trouvent de plus en plus le courage de parler et de se battre contre cet état de fait, il y a des raisons d’espérer que ça change. Au même titre que les lanceurs d’alerte qui se multiplient.
Justine : Ça c’est pour ce qui relève du livre, mais il y a tout de même eu, depuis le début du projet quelques petites victoires. Après l’enquête, des activistes ukrainiens se sont saisis de la question pour porter des propositions au parlement pour sanctionner plus sévèrement ces actes, et un projet de loi est en cours. En France, les producteurs et réalisateurs d’a BAHN ont obtenu, après moult discussions, un rendez-vous au ministère des armées. Si le contenu de ce rendez-vous a été décevant, ça montre qu’ils nous ont vus, qu’ils ont compris qu’on était là et qu’on continuerait à poser des questions.
Anne-Laure : Des gens sont venus vers nous après les articles de Médiapart. Il y a eu les pétitions. Et puis maintenant le livre. Les gens nous disent que c’est important de parler de ça.
Justine : Et dire que ça peut bouger n’est pas être bisounours avec des discours “ensemble tout est possible, en faisant des grandes rondes et en se tenant la main”. Non. C’est aussi être réaliste et se rendre compte que pour certaines institutions et personnes, il n’y a pas intérêt à ce que ça reste impuni. L’armée française est quand même toujours gênée aux entournures quand on parle de viol et de violence. S’il est possible de faire un certain nombre de choses pour prévenir ou pour sanctionner, on a espoir que ça sera fait. Non pas parce qu’on a un espoir fou en l’humanité ou dans l’état major français, mais parce qu’il y a des points de pression, il y a des choses sensibles.
NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,
ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

